
sur le tournage de Colour out of space
Le nouveau film de Richard Stanley, Colour out of space, présenté il y a quelques jours au PIFF, montre la difficulté à adapter les textes du grand H.P. Lovecraft.
« Partout ces variations prismatiques et délirantes des tons primaires comme devenus malades, sans aucune place parmi les teintes connues sur la Terre. » Plus loin : « C’était une scène digne d’une vision de Füssli, et partout autour régnait cette débauche de luminosité amorphe, arc-en-ciel de poison énigmatique (…) venant du puits — bouillonnant, flairant, lapant, attrapant, scintillant, forçant et boursouflant malignement dans son chromatisme cosmique inconnaissable. »
En lisant ces extraits de La Couleur tombée du ciel, nouvelle de H. P. Lovecraft (dans la traduction de François Bon), on voit la difficulté à porter à l’écran l’imaginaire de l’écrivain de Providence, qui inventa le Necronomicon et le mythe de Cthulhu : des couleurs qui n’existent pas, des créatures indescriptibles, de « l’inconnaissable » à gogo, à chacun de se débrouiller avec ça.
De fait, les (bonnes) adaptations de Lovecraft ne sont pas légion – a fortiori puisque Guillermo Del Toro n’a jamais réussi à faire financer sa version des Montagnes hallucinées. John Carpenter a emprunté à Lovecraft dans des films qui ne sont jamais directement tirés de textes de l’écrivain, mais qui montrent son influence, comme L’Antre de la Folie ou The Thing.

Et la version 2019 de La Couleur tombée du ciel (Colour Out of Space), signée Richard Stanley ? Découvert au PIFFF, le film incite plutôt à l’indulgence, eu égard aux états de service du cinéaste. Il a fallu vingt-quatre ans pour que le réalisateur sud-africain reprenne les commandes d’un long-métrage de fiction. On sait peut-être qu’il est devenu une semi-légende chez les amateurs de ciné fantastique pour avoir été viré au bout de trois jours (ou quatre, ou quelques semaines, selon les versions) du plateau de L’Ile du Docteur Moreau avec Val Kilmer et Marlon Brando, à l’été 1995.
Opinion communément admise : sa version du livre de H.G. Wells aurait été meilleure que celle in fine signée du vétéran John Frankenheimer – alors au pénible crépuscule de sa carrière. Il y a cinq ans, un doc (Lost soul : The Doomed journey of Richard Stanley’s Island of Dr. Moreau) revenait sur la pagaille d’un tournage chaotique, entre mauvais temps et caprices de Brando, où l’on apprenait notamment que Stanley était revenu incognito sur le tournage du film qu’on lui avait retiré, errant parmi les figurants grimé en créature mi-bête mi-humaine…
Tourné au Portugal, financé par de l’argent malaisien (!), joué par Nicolas Cage en roue libre, qui cuisine du cassoulet, trait des alpagas (qui ne sont pas exactement des lamas) et plaisante sur sa calvitie, Colour out of space reprend malgré ces facéties la trame de la nouvelle : la chute d’une puissance extra-terrestre informe et malfaisante – mais colorée – au fond du puits d’une ferme de Nouvelle-Angleterre. Mais l’action est désormais contemporaine et la « couleur » maléfique s’acharne moins à détruire un territoire (la fameuse « lande foudroyée » du livre) qu’à martyriser une famille de néo-ruraux vaguement bobos.
Il y a quelques beaux moments horrifiques, comme la fusion d’une mère et de son fils en une créature unique, difforme et gémissante. Et aussi quelques effets chromatiques sympathiques – mais pas de couleur jamais vue. On jurerait que le cinéaste s’est surtout intéressé au démantèlement d’une famille vaincue par la maladie (de la mère), les errements professionnels (du père), l’ennui (des enfants), bref cette bonne vieille cocotte-minute de la fiction occidentale en phase d’implosion. Révélation tardive : le fantastique, même (ou a fortiori) quand il explore d’autres mondes, ne parle jamais que de nos névroses.
Curieusement, c’était le même choix – la dislocation d’une cellule familiale – choisie lors d’une précédente adaptation, en 1965, de La Couleur tombée du ciel (revue par désoeuvrement acquit de conscience) : produit par Roger Corman, assez platement mis en image par son chef déco attitré, Daniel Haller, Le Messager du diable (fausse piste), en anglais, Die, monster, die, mettait en scène Boris Karloff en patriarche tentant de sauver les meubles d’une maisonnée en parfaite décomposition, épouse se transformant en bouillie anatomique, domestiques tombant comme des mouches. Il y avait du Poe dans ce Lovecraft-là. Et toujours l’impuissance humaine, non pas tant face au mal, mais à l’inéluctable pourrissement et décomposition des chairs.
Aurélien Ferenczi
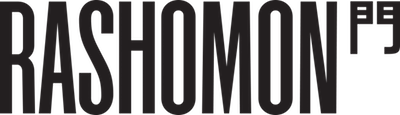





Leave A Comment