
AGENTS DOUBLES, DOUANIERS SUSPICIEUX, TRAQUE DANS RUES MOUILLÉES DES CAPITALES DE L’EST : LA GUERRE FROIDE A INSPIRÉ LES CINÉASTES.
J’ai fini de regarder Totems, la série d’espionnage dont Prime Video a distillé les dix épisodes sur plusieurs semaines, ce qui l’a rendue de plus en plus actuelle : l’invasion russe en Ukraine et la menace nucléaire qui l’accompagne ont fini par rimer de façon spectaculaire avec cet épisode de la guerre froide imaginé par Olivier Dujols et Juliette Soubrier (et produit par Jérôme Salle – c’est un peu compliqué de savoir qui fait quoi dans les séries, mais le dire comme ça me paraît à peu près juste).
L’histoire, celle d’un ingénieur aérospatial (Nils Schneider) recruté par le SDECE pour obtenir d’un savant russe des infos fondamentales pour la sécurité de la planète, comporte son lot d’invraisemblances. Mais elle offre quelques vrais moments de suspense – un embarquement sous surveillance à l’aéroport de Prague, notamment – et retrouve ici ou là le charme des « contes et légendes de la guerre froide », dont le canon esthétique pourrait venir du Troisième homme : pavés luisants d’une ville de l’Est (dans ce cas, Prague), personnages qui s’avèrent brutalement des agents doubles, séduisant patchwork linguistique – au moins, ici, les Soviétiques, bien joués par des acteurs russes, parlent la langue de Pouchkine. J’ai aussi pensé aux aventures de Tintin – beaucoup de poursuite dans des tunnels et de petits avions qui atterrissent dans des champs transformés en pistes de fortune. Dans L’Affaire Tournesol, il est aussi question de transfuge – Tournesol capturé par des espions bordures.

J’ai eu envie de revoir quelques films du même genre – dont certains, j’imagine, ont été également inspectés par les créateurs de Totems. Je passe sur les plus récents, type Maison Russie ou (magnifique) Pont des espions. Je cherchais plutôt des films contemporains du récit de Totems – les années 60.J’avais un souvenir amusé de Pas de lauriers pour les tueurs (Mark Robson, 1963), là encore une histoire de savant qu’on essaye de faire passer de l’autre côté du rideau de fer. Paul Newman y joue un romancier américain dragueur et vaguement alcoolo, venu à Stockholm recevoir un inattendu Prix Nobel. Parmi les autres nobellisés, un savant allemand qui a choisi l’exil aux États-Unis et que la RDA aimerait bien enfin récupérer. Newman, observateur, comprend qu’il y a quelque chose de louche…
Un Prix Nobel aux trousses
Le film est écrit par Enest Lehman, qui a signé pour Hitchcock le scénario de La Mort aux trousses et c’est de fait une Mort aux trousses au rabais, où Newman parodie gentiment Cary Grant, avec une scène dans un club naturiste qui rappelle le passage où Roger Thornhill parvient à s’échapper d’une vente aux enchères. Plagiat paresseux, un peu avare en scènes d’action – beaucoup de combats poussifs entre Newman et un « bad guy » joué par le légendaire Sacha Pitoëff – mais il y a Edward G. Robinson, impeccable, et le plan d’un moribond, en haut d’un escalier, veillé par deux femmes, que je crois avoir retrouvé dans Totems…
Enchaîner dans la foulée avec Le Rideau déchiré, de Sir Alfred Hitchcock (1966), est éclairant à plus d’un titre : on y apprend, en trois images, que la mise en scène, c’est l’art du temps, une façon spécifique de découper le réel (ou sa représentation), qui, d’un coup, redonne tout son sérieux à ce qui pouvait être semi-parodique dans le film de Robson ; et on voit Paul Newman, encore lui, y croire un peu plus que dans le film d’avant, et faire passer le danger que court son personnage.

L’intrigue est moins réussie que les ambiances qu’elle parvient à créer : Newman joue un savant américain qui, butant dans ses recherches, va chercher la solution auprès d’un collègue est-allemand, et pour cela, fait mine de passer à l’Est. Problème : incrédule face à son revirement idéologique, sa fiancée l’a suivi derrière le Mur… À vrai dire, on imagine mal les services secrets alliés planifier une telle opération – le retour vers l’Ouest est d’ailleurs facilité par une organisation clandestine d’Allemands pacifistes et je ne sais pas si cet underground railroad-là a vraiment existé. plateau…
Remarquons que, pour s’évader, Newman et Andrews assistent à un ballet dans un théâtre de Berlin-Est exactement comme dans L’Affaire Tournesol, quand Tintin et Haddock se cachent à l’opéra de Szohôd, Bordurie, où chante la Castafiore.
Les mauvaises manières de Paul Newman
Dans sa bio d’Hitchcock, Patrick McGilligan raconte que le cinéaste ne s’est pas du tout entendu avec les comédiens. Newman était tombé en disgrâce le jour où, invité à dîner par Hitch et Alma, il avait retiré sa veste, l’avait posée sur le dossier de sa chaise, puis, refusant le vin rouge choisi avec soin par ses hôtes, il était allé se chercher tout seul une bière dans le frigo, préférant la boire à la bouteille…Shocking !
Quant à Julie Andrews, elle avait vu son rôle diminuer au fil des versions du scénario – l’idée initiale, intéressante, était d’en faire le personnage principal, en état de sidération permanente. Bref, c’était pas la joie sur le plateau… Pour finir, c’est aussi le film où Hitchcock s’est définitivement fâché avec Bernard Herrmann, lui réclamant, par jeunisme une partition « pop » que l’autre ne voulait/savait pas faire.

Ces deux films ont plutôt agréablement étanché ma soif de #rideaudefer #espion #défection #communiste #paysdelest mais tout de même, par pure conscience cinéphile, j’ai eu envie de jeter un oeil à L’Espion qui venait du froid, de Martin Ritt, réalisé en 1965 d’après le livre de John le Carré, son premier grand succès. Je me suis aperçu que 1/ je ne l’avais jamais vu 2/ c’est un chef-d’œuvre incroyable qui montre l’espionnage comme une vraie saloperie. En noir et blanc, abondamment et finement dialogué (avec un numéro incroyable d’Oskar Werner, ex-acteur truffaldien) le film est plus Melvillo-Bressonien qu’autre chose.
On y voit Richard Burton, visage marqué, haleine d’alcoolo, feindre de passer à l’Est après avoir été faussement viré du MI6, dans le but de discréditer un espion est-allemand, sans savoir qu’il est lui-même manipulé. Il entraîne dans son sillage une jeune bibliothécaire innocente et idéaliste, jouée par Claire Bloom. C’est d’une maîtrise narrative et visuelle incroyable (image néo-expressioniste d’Oswald Morris, chef-op sous-coté de Huston et Lumet, entre autres), et ça dit que la Guerre froide, les jeux d’espions, les relations internationales, c’est une sacrée cochonnerie.
Quand Le Carré couvait Burton
En 2013, John Le Carré se rappelait, dans The New Yorker, la façon dont le cinéma était venu le chercher, alors qu’il était encore diplomate à Bonn. Martin Ritt avait acquis les droits d’adaptation du livre avant parution et pour lui, homme de gauche un temps menacé par le maccarthysme, son thème avait beaucoup d’importance : « il voyait dans mon roman une sorte de point de passage entre ses convictions antérieures et son état actuel de dégoût impuissant face au maccarthysme, à la lâcheté d’un trop grand nombre de ses pairs et camarades à la barre des témoins, à l’échec du communisme et à la stérilité écœurante de la guerre froide. »

Après avoir reçu et apprécié le scénario, Le Carré pensait que son rôle s’arrêterait là. Mais, raconte-t-il, « quelques nuits plus tard, mon téléphone a sonné. C’était Ritt, qui appelait des studios Ardmore, en Irlande, où le tournage était censé avoir commencé. Sa voix avait l’étranglement d’un homme qui a été pris en otage et qui délivre son dernier message.
– Richard a besoin de toi, David [le vrai prénom de Le Carré]. Il a tellement besoin de toi qu’il ne dira pas son texte avant que tu ne l’aies réécrit.
– Mais qu’est-ce qui ne va pas avec les répliques de Richard, Marty, elles me semblaient bien.
– Ce n’est pas la question, David. Richard a besoin de toi, et il va retarder la production jusqu’à ce qu’il t’ait. On te paiera ton billet en première classe et tu auras ta propre suite.
Que demander de plus ? » Alors, Le Carré était devenu l’accompagnateur personnel de Burton tout au long du tournage, lui mettant les mots en bouche, veillant à ce que l’agacement de Martin Ritt face à un comédien génial, mais en pleine auto-destruction éthylique, ne fasse pas trop de dégâts. Il raconte ainsi un soir de tournage à Dublin figurant Berlin, où Burton, ivre, n’arrivait pas à escalader le Mur (avec un grand M) comme requis par le scénario, quand débarqua, en Rolls Royce blanche, Elizabeth Taylor, semant la pagaille sur le plateau. Parfois, le cinéma, c’est aussi compliqué que l’espionnage.
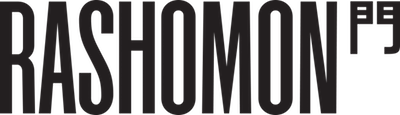

Leave A Comment